11 avril 2017 – [datedermaj]
La prise de vues aériennes en France, quel que soit le vecteur utilisé (drone, ballon, ULM, avion, hélico…) est très encadrée et constitue une profession réglementée. Cet article fait suite à de nombreuses questions sur le sujet, par des amateurs, professionnels de l’images ou autres. Il s’agit donc d’une synthèse qui tente de répondre à la question: qui peut pratiquer la prise de vues aériennes en France et dans quelles conditions ?
Principe général et questions de vocabulaire
La réglementation en France sur la prise de vues aériennes est ancienne et concernait il y a encore quelques années que les aéronefs habités. Puis, ce fut l’époque des ballons captifs pour les prises de vues à basse altitude. Enfin, elle a ensuite été légèrement adaptée, sur le même principe, pour les aéronefs non habités (drones).
Vous trouverez à la suite, les définitions de certains termes utilisés dans le cadre de cette pratique, quels que soit les vecteurs utilisés (avions, hélicos, ULM, drones…).
Les activités particulières sont des professions réglementées qui correspondent au travail aérien. Elles nécessitent une déclaration préalable d’activité auprès de la Direction Générale de l’Aviation Civile (D.G.A.C). Les différentes activités particulières sont :
- les traitements agricoles, phytosanitaires ou de protection sanitaire et les autres opérations d’épandage sur le sol ou de dispersion dans l’atmosphère ;
- le largage de parachutistes (pas en drone, bien évidemment) ;
- le largage de charges de toutes natures ;
- le transport de charges à l’élingue ;
- l’hélitreuillage ;
- le remorquage de banderoles ;
- la lutte contre l’incendie ;
- les relevés, photographies, observations et surveillances aériennes nécessitant la mise en place de dispositifs spécifiques ;
- toute autre activité nécessitant une dérogation aux règles de la circulation aérienne générale ainsi que la formation à ces activités.
L’exploitant d’aéronefs sans personne à bord (drones) ou habités (avion, hélico, ULM…) réalisant des images aériennes (activités particulières) est donc classé dans les professions réglementées comme par exemple: huissiers de justice, architecte, entreprise de déménagement, agent de sécurité, taxi, géomètre expert, pharmacien, médecin, avocat, coiffeur, boulanger-pâtissier, boucher-charcutier, notaire, entreprise générale de construction, agent immobilier…etc. C’est-à-dire qu’elles sont soumises à l’autorisation ou l’agrément préalable d’une autorité compétente (DGAC dans notre cas).
Pour cette raison, le tribunal de commerce est alors amené à vérifier le respect de cette condition d’exercice de la profession réglementée concernée, lors de votre demande d’immatriculation ou d’une demande d’inscription modification, au registre du commerce et des sociétés, comme micro-entrepreneur ou société: EURL, SARL, SAS…Il est demandé de fournir la copie du justificatif autorisant à exercer. Dans notre cas, après la première déclaration d’activité à la DGAC, l’accusé de réception de la DGAC devra être transmis au tribunal de commerce à cette fin.
La liste des professions réglementées n’est pas toujours à jour selon les tribunaux de commerce. Et quand ces derniers demandent des justificatifs, parfois certains exigent de fournir en plus un MAP alors que ce document n’est plus demandé par la DGAC pour la déclaration initiale d’activité, depuis déjà quelques années. N’hésitez pas à rappeler le texte en vigueur sur le sujet: arrêté du 17 décembre 2015.
Hauteurs minimales ou maximales de survol ?
La pratique de la prise de vues aériennes est soumise notamment aux contraintes réglementaires liées aux hauteurs de vols autorisées, que cela soit avec un aéronef habité ou non (drone).
En France, pour les aéronefs habités, les hauteurs minimales de survol sont réglementées par un vieil arrêté (10 octobre 1957) qui décrit les hauteurs minimales au dessus des populations, et un autre plus récent (3 mars 2006) pour les généralités et les dérogations.
Prenons l’exemple d’agglomérations dont la largeur moyenne est inférieure à 1200 mètres, mais aussi les plages, stades, hippodromes, zoo, spectacles en plein air, etc. La hauteur minimale de vol est alors de 500 mètres (1700 pieds) pour les monomoteurs uniquement. Les avions multi-moteurs doivent respecter une hauteur de 3300 pieds (1000 mètres) minimum.
Par exemple, en cas de survol côtier; le niveau de vol est autorisé à : 500 pieds (152 mètres) au dessus de l’eau, mais au moins 1700 pieds (500 mètres) au dessus d’une plage, Des dérogations aux hauteurs minimales de vol peuvent être accordées à un opérateur aérien (exploitant) pour permettre l’exécution de travaux aériens présentant un caractère d’intérêt général ou économique et ne pouvant être effectués à des hauteurs réglementaires. Nous le verrons à la suite.
[error]Ne pas respecter les règles de hauteurs minimales, c’est se mettre en danger, mettre en danger les personnes au sol. Ce type d’infraction peut entraîner des mesures disciplinaires, voir des poursuites judiciaires. Certains pilotes se voient privés de leur licence, chaque année, à cause de pratiques douteuses.[/error]
En France, pour les aéronefs non habités (drones), c’est l’arrêté du 17 décembre 2015 qui définit la hauteur maximale de vol qui est 150 mètres, en dehors des emprises d’aérodromes ou d’aéroports, CTR…Si besoin, il est possible, comme exploitant, d’obtenir une dérogation auprès de la DGAC, avec un délai minimum de 30 jours (lire plus bas).
Les zones interdites aux prises de vues aériennes ?
L’article D133-10 du code français de l’aviation civile prévoit que la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne est déposée dans les préfectures, les directions régionale de l’aviation civile, les districts aéronautiques ou, pour les territoires d’outre-mer, dans les bureaux des délégués du Gouvernement et les services de l’aviation civile. Il appartient également au télépilote et à son employeur éventuel (exploitant professionnel de drones) de s’assurer, auprès des organismes précités, de la possibilité d’effectuer librement des prises de vues aériennes. En pratique, cette disposition n’est pas des plus aisée à appliquer, avec les contraintes administratives, de terrain, de délais…. Un arrêté du 27 octobre 2017 complète cet article et précise donc les zones interdites à toute captation aérienne au dessus du territoire français.
L’article D133-10 du code français de l’aviation civile prévoit pour les professionnels que: “Des dérogations à ce principe peuvent être accordées pour une zone interdite figurant sur la dite liste par le ou les ministres de tutelle de cette zone”. Le ou les ministères de tutelles des zones interdites sont précisés dans l’annexe de l’arrêté du 27 octobre 2017 pour chacune d’elles.
« Zones interdites aux prises de vues aériennes en France ».
Prise de vues aériennes depuis un avion ou un hélico ?
 L’aéronef utilisé ne peut être mis en œuvre que par une société de photographie aérienne (ou une société de travaux aériens utilisée en sous-traitance par un photographe) dénommé l’exploitant, responsable de l’organisation ou de la pratique d’une telle activité.. Il aura déposé préalablement un manuel d’activités particulières (M.A.P.) auprès de l’aviation civile (DSAC territorialement compétente) mentionnant expressément l’activité concernée. Dans notre cas, il s’agit de: relevés, photographies, observations et surveillances aériennes nécessitant la mise en place de dispositifs spécifiques .
L’aéronef utilisé ne peut être mis en œuvre que par une société de photographie aérienne (ou une société de travaux aériens utilisée en sous-traitance par un photographe) dénommé l’exploitant, responsable de l’organisation ou de la pratique d’une telle activité.. Il aura déposé préalablement un manuel d’activités particulières (M.A.P.) auprès de l’aviation civile (DSAC territorialement compétente) mentionnant expressément l’activité concernée. Dans notre cas, il s’agit de: relevés, photographies, observations et surveillances aériennes nécessitant la mise en place de dispositifs spécifiques .
Comme nous l’avons vu plus haut, des dérogations aux hauteurs minimales de vol peuvent être accordées à un opérateur aérien (exploitant) pour permettre l’exécution de travaux aériens présentant un caractère d’intérêt général ou économique et ne pouvant être effectués à des hauteurs réglementaires. C’est le cas par exemple des activités de surveillance ou de prises de vues. Ces dérogations ne concernent que les vols effectués en régime de vol à vue, de jour:
- Les dérogations de vol rasant émises par l’aviation civile (DGAC) pour des prises de vues hors agglomération, qui permettent des vols en dessous du plancher habituel (150 mètres/sol) avec un minimum de 50 mètres/sol, voir moins dans certains cas.
- Les dérogations de survol d’agglomérations émises par la préfecture du département concerné si des prises de vues doivent s’effectuer au dessus de zones habitées ou de rassemblements de personnes.
Ces dernières dérogations ne peuvent être délivrées que dans le cas d’avions ou d’hélicoptères (pas d’ULM) pilotés par des pilotes professionnels titulaires de DNC (Déclaration de Niveau de Compétence) pour la prise de vues aériennes.
Les dérogations de survol obtenues n’autorisent bien sûr pas tout. Elles limitent les hauteurs de vol minimales à un niveau considéré suffisant pour la sécurité. En effet, même en cas de panne moteur, l’aéronef doit toujours pouvoir quitter la zone concernée, pour réaliser un atterrissage d’urgence, sans risque pour les personnes et les biens au sol.
Prise de vues aériennes depuis un ULM ?

ULM MDC 912 dédié au travail aérien de Humbert Aviation – photo Humbert Aviation
Même principe que pour les avions et hélicos (lire plus haut), mais les ULM de tous types (3 axes, pendulaires, paramoteurs) ne peuvent obtenir les dérogations évoquées plus haut car ils ne sont pas certifiés. Par conséquent, ils ne peuvent donc pas être utilisés pour des prises de vues en zones urbaines (au sens aéronautique une agglomération est une commune de plus de 1000 habitants) ou de rassemblement de personnes.
Prise de vues aériennes avec drones et ballons téléopérés ?

[plain] L’administration française (DGAC) a apporté quelques précisions pour différencier une activité de loisir (aéromodélisme), d’une activité professionnelle (activités particulières) avec un drone, depuis son avant-dernière édition (9 août 2016) du Guide des activités particulières:
- Ce qui compte est l’objectif du vol au moment où il est réalisé (loisir/compétition ou pas), et non pas le cadre juridique ou économique dans lequel il est réalisé.
- Par exemple, le fait que l’exploitant soit ou non une société et que le vol donne lieu ou non à une transaction commerciale ne sont pas des critères.
- Dès lors que le but du vol n’est pas le loisir du télépilote (pilotage ou prise de vues), il s’agit d’une “activité particulière” (professionnelle) ou d’une expérimentation (cas particulier) qui nécessitent d’être déclaré à la DGAC.
[/plain]Les prises de vues aériennes professionnelles, ou ayant un but commercial avec des aéronefs non habités télépilotés rentrent dans le champ des activités particulières (travail aérien), régies notamment par les deux arrêtés du 17 décembre 2015.
L’article 1 de l’arrêté du 17 décembre 2015. prévoit qu’il ne s’applique pas :
- aux ballons libres ;
- aux ballons captifs utilisés à une hauteur inférieure à 50 mètres avec une charge utile d’une masse inférieure ou égale à 1 kilogramme ;
- aux fusées ;
- aux cerfs-volants ;
- aux aéronefs (dont drones) utilisés à l’intérieur d’espaces clos et couverts.
Les télépilotes professionnels de drones ou ballons captifs doivent être titulaires de DNC (Déclaration de Niveau de Compétence), sur le même principe que les pilote d’aéronefs habités (lire plus haut). Les structures qui les emploient doivent être déclaré auprès de la DGAC comme exploitant d’aéronefs non habités (drones) et disposer d’un manuel d’activités particulières (M.A.P.) mentionnant expressément l’activité de prise de vue aériennes sur le même principe que les aéronefs habités.
 Selon le scénario de vol (S1 ou S3) et la configuration des lieux s’ajoute des démarches administratives (Dossier d’autorisation de vol auprès de la préfecture compétente et de la DGAC si nécessaire), le suivi d’un protocole défini avec l’exploitant d’une zone réglementée, l’occupation du domaine public…
Selon le scénario de vol (S1 ou S3) et la configuration des lieux s’ajoute des démarches administratives (Dossier d’autorisation de vol auprès de la préfecture compétente et de la DGAC si nécessaire), le suivi d’un protocole défini avec l’exploitant d’une zone réglementée, l’occupation du domaine public…
Lors de la mission, le télépilote doit baliser la zone d’exclusion des tiers pour sécuriser les lieux, réaliser de nombreux contrôles avant et après chaque vol, tenir à jour son carnet de vol, noter les tâches de maintenance dans un carnet d’entretien…
Le télépilote peut très bien travailler en binôme, par exemple, avec un cadreur, ou un réalisateur (personne en lien avec l’activité), à ses côtés (dans la zone d’exclusion des tiers), à condition de lui avoir fait signer une attestation précisant qu’il a bien pris connaissance des consignes de sécurité à respecter.
Quel pilote ou télépilote choisir pour des prises de vues aériennes ?
Comme nous l’avons vu plus haut, la prise de vues aériennes, à des fin de commercialisation directe ou indirecte, ne peut être réalisée que par des professionnels déclarés à l’aviation civile (DGAC), quel que soit l’aéronef utilisé (drone, avion, hélico, ULM…).
 Assurez-vous que le prestataire de prises de vues aériennes (avec drones ou autres aéronefs) que vous souhaitez faire intervenir est déclaré comme exploitant d’aéronefs dans le cadre d’activités particulières (travail aérien) auprès de la DGAC, en conformité avec la réglementation et qu’il dispose bien d’une assurance en responsabilité civile (RC) professionnelle aérienne pour garantir les risques en cas de sinistre. En effet, la responsabilité du donneur d’ordre (client) pourrait être engagée en cas de sinistre occasionné lors d’une prestation avec un aéronef ou un pilote non autorisé(s) ou non assuré(s).
Assurez-vous que le prestataire de prises de vues aériennes (avec drones ou autres aéronefs) que vous souhaitez faire intervenir est déclaré comme exploitant d’aéronefs dans le cadre d’activités particulières (travail aérien) auprès de la DGAC, en conformité avec la réglementation et qu’il dispose bien d’une assurance en responsabilité civile (RC) professionnelle aérienne pour garantir les risques en cas de sinistre. En effet, la responsabilité du donneur d’ordre (client) pourrait être engagée en cas de sinistre occasionné lors d’une prestation avec un aéronef ou un pilote non autorisé(s) ou non assuré(s).La liste des exploitants déclarés auprès de la DGAC, pour la prise de vues aériennes au moyen de drones est mise à jour tous les jours, par la D.G.A.C, de manière automatique, sous la forme d’un fichier Excel (.xls) téléchargeable, sur la page d’accueil d’AlphaTango, dans la rubrique “Liens utiles” en bas de page à droite.
Prises de vues aériennes et autres déclarations ?
En plus d’être professionnel, déclaré à la DGAC, d’autres demandes d’autorisations sont prévues par l’article D. 133-10 du code de l’aviation civile. Elles sont délivrées par le représentant de l’Etat dans le département ou le délégué du Gouvernement dans le territoire où l’utilisateur est domicilié et par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie du département, du territoire ou de Paris et du directeur régional chef de secteur de la police de l’air et des frontières.
[error]Toute personne qui souhaite réaliser des enregistrements d’images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national est tenue de souscrire une déclaration au plus tard quinze jours avant la date ou le début de période prévue pour l’opération envisagée auprès du chef du service territorial de l’aviation civile (DSAC) dont relève son domicile. Pour les personnes résidant à l’étranger, la déclaration est faite auprès du chef du service territorial de l’aviation civile compétent pour Paris. Aujourd’hui, cette déclaration pour le spectre visible est valable pour une durée d’un an et peut être demandée pour l’ensemble du territoire national. Sont également assujetties à la possession d’une autorisation, les personnes utilisant tout appareil d’enregistrement d’images ou de données en dehors du spectre visible tel que thermographe, radar, LIDAR, etc. Cette autre déclaration est à réaliser auprès de la préfecture de résidence. Après une enquête de gendarmerie ou de police et avis du directeur zonal de la police aux frontières, un arrêté préfectoral est alors délivré, selon le cas. Cette autorisation pour le spectre non visible est valable pour une période de trois ans, à compter de la date de la décision, à condition de respecter la réglementation. En effet, conformément à l’article D. 133-11 du code de l’aviation civile, l’autorisation peut être suspendue ou retirée en cas d’infraction à la réglementation en vigueur.[/error]
« Zones interdites aux prises de vues aériennes en France ».
Exception relative à la prise de vues aériennes et aux déclarations ?
L’article D133-10 du code français de l’aviation civile prévoit: “Est dispensée de la déclaration mentionnée au septième alinéa la prise de vues photographiques ou cinématographiques effectuée à titre occasionnel et à finalité de loisirs par un passager, au cours d’un vol dont l’objet n’est pas la prise de vues.”
[info]En 2005, lors de la publication de cet article du code de l’aviation civile, les drones n’étaient pas répandus et les prises de vues aériennes étaient réalisées depuis des aéronefs habités: ULM, avion, hélico, montgolfière…d’où le terme employé de passager. Depuis, les drones se sont ajoutés comme autres vecteurs de prises de vues aériennes.[/info]
Par conséquent, si vous pratiquez le drone comme loisir, que la prise de vues n’est pas votre objectif principal et que vous ne diffusez pas vos images en dehors d’un usage strictement privé, vous pouvez bénéficier de cette exception de déclaration.
Constats récurrents de dérives en matière de prises de vues aériennes
On constate régulièrement des dérives sur le sujet des prises de vues aériennes. Il suffit de regarder des vidéos postées sur YouTube, sur les sites web de certains hôtels ou campings, voir d’offices de tourisme ou de collectivités territoriales. Les prises de vues aériennes sont réalisées le plus souvent par des professionnels de l’image non déclarés, des employés de collectivités territoriales, des entreprises de presse ou par des employés passagers d’aéronefs ou des particuliers qui travaillent de manière dissimulée (travail dit au noir) afin d’arrondir leurs fins de mois.
Type de scénario assez récurrent, depuis quelques temps, sur la toile:
Une entreprise de presse ayant “pignon sur rue” fait la promotion des images vidéo d’un jeune “télépilote de drone amateur” qui souhaiterait devenir professionnel. Le site du média propose un lien vers une de ses vidéos postée sur Youtube ou Vimeo qui montre le survol illégal d’une ville, avec des évolutions au dessus de la circulation automobile et des piétons. La vidéo est donc en libre d’accès, sans cession et paiement de droits pour son utilisation. Bien évidemment, cette situation créé un véritable “buzz”, gratuit, avec du traffic vers la page de l’article qui en fait la promotion. Ce dernier est notamment alimenté par des commentaires parfois houleux entre un certain public contemplatif, voir admiratif des vues originales de la ville qui défend le “jeune talentueux” en minimisant son délit et les professionnels du secteur qui sont outrés de constater de telles pratiques dangereuses, qui enfreignent la réglementation alors que ces derniers sont soumis à des contraintes importantes pour le survol en agglomération, en scénario S3.
Mais où est donc la déontologie journalistique et la responsabilité de diffuseur, quand certains font la promotion de pratiques dangereuses et d’un délit ? De plus, dans certains cas, c’est en connaissance de cause. En effet, certains médias malgré des commentaires ou contacts de professionnels, réitèrent, parfois quelques semaines plus tard, le même type de scénario.
Proposition pour limiter les dérives en matière de prises de vues aériennes
La solution pourrait consister à afficher le numéro de déclaration d’exploitant, quel que soit le vecteur aérien utilisé (drone, avion, ULM, hélico…) avec le crédit photo ou au générique du film, afin d’attester de l’utilisation des services d’un professionnel déclaré à la DGAC. En partie, sur le même principe, pour sa matérialisation lors de la diffusion, que le numéro de visa d’exploitation qui est apposé sur un film. Ce dernier est une autorisation administrative nécessaire à tout film exploité dans les salles de cinéma, quelle que soit son origine, française ou étrangère. Il est demandé en France, auprès du Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC).
Cela pourrait donner, par exemple:
© Denis JEANT – ED567
[info]Au passage, rien n’empêche les exploitants ou/et les pilotes d’aéronefs habités ou les télépilotes professionnels de drones, titulaires d’une DNC de le faire, sans attendre un nouveau texte réglementaire ou une nouvelle loi.[/info]
Il est également important de sensibiliser à la réglementation et à ces dérives, les producteurs, diffuseurs d’images aériennes (via leurs organismes représentatifs, organismes ou écoles de formation et acteurs majeurs du secteur…), comme des organismes de régulation, comme le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) en France.
De même des dispositions législatives et/ou réglementaires pourraient être adoptées pour responsabiliser les différents acteurs, en prévoyant des sanctions, en cas de récidive:
- Obligation pour les producteurs d’images aériennes (TV, sociétés de production, médias, collectivités territoriales, offices de tourisme, agences de communication…), avant tout tournage ou reportage photo réalisé en France métropolitaine ou dans les DOM-COM, d’exiger de l’opérateur d’images aériennes envisagé, de fournir la copie de son récépissé de déclaration d’activité à la DGAC comme exploitant d’aéronefs non habités (drones) ou habités (ULM, avion, hélico…);
- Obligation pour les producteurs d’images aériennes, avant tout tournage ou reportage réalisé en France métropolitaine ou dans les DOM-COM, d’exiger de l’opérateur d’images aériennes envisagé, de fournir la copie de son attestation d’assurance RC professionnelle aérienne;
- Obligation pour les diffuseurs d’images aériennes (TV, Internet, presse écrite, cinéma, DVD, films à la demande, communication commerciale et institutionnelle, diffusion publique…), pour toute captation aérienne en France métropolitaine ou dans les DOM-COM, de préciser le numéro d’exploitant DGAC, avec le crédit photos ou dans le générique du film.
Utilisez les commentaires, en bas de cette page !
Découvrez nos autres articles en ligne, dans la partie “Blog” du site.




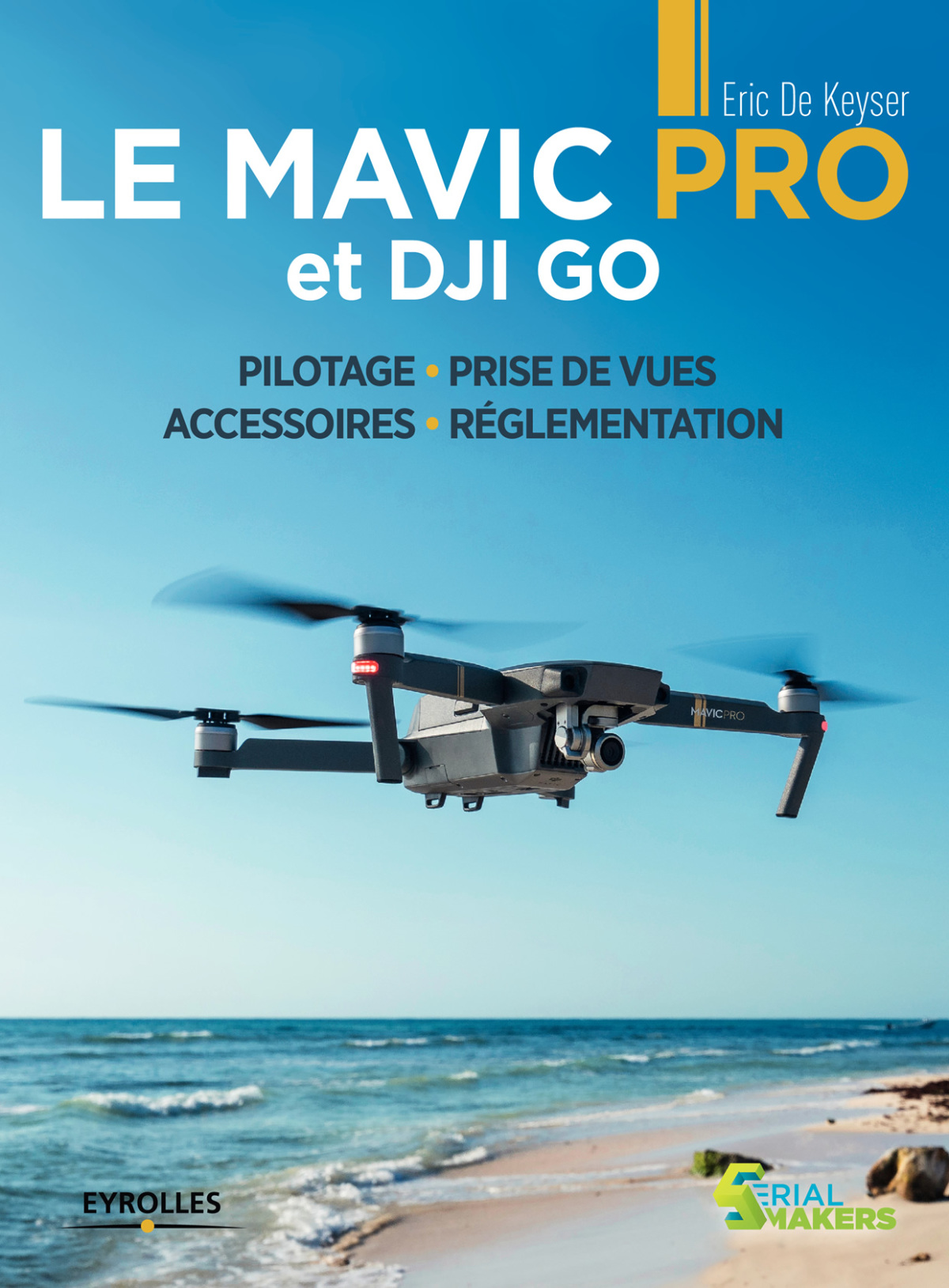

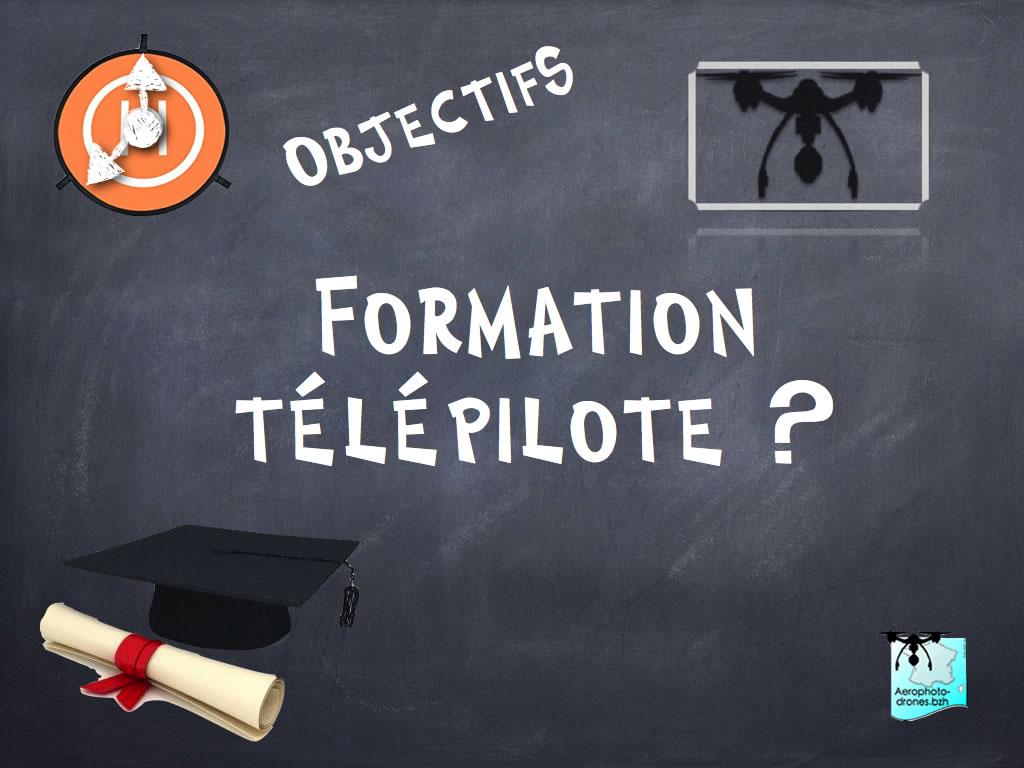













Bonjour,
Concernant la déclaration sur cerfa 12546*01 ; cet imprimé est-t-il d’actualité pour les activités drone ? En le consultant, je trouve que les rubriques ne sont pas toutes adaptées et dans quel cas, devons-nous remplir cet imprimé.
Merci pour vos commentaires et réponse
Bonjour Philippe,
Le cerfa 12546*01 ne concerne que la captation aérienne dans le spectre dit visible, la plus communément employée (hors infrarouge, LIDAR ou autres… qui nécessitent un autre type de déclaration auprès de la préfecture…).
Oui, le CERFA 12546*01 est toujours d’actualité mais a été conçu à une époque où les drones n’étaient pas encore répandus. En effet, l’arrêté portant application de l’article D133-10 du code de l’aviation civile date de plus de 12 ans. Plus exactement, du 27 juillet 2005, avec parution aux J.O le 29 juillet 2005. Il n’a pas été revu par l’administration depuis. De même, la réglementation s’applique aussi pour les autres aéronefs, habités (avion, hélico, ULM…) qui étaient les seuls à opérer au début.
Pour la licence de pilote, vous indiquez le numéro de votre certificat d’aptitude ULM, dans l’attente d’une licence spécifique drone qui a été annoncée et qu’on attend.
Je vous recommande de préciser pour l’ensemble du territoire national et pour une période d’un an de date à date. Par exemple de février 2018 à février 2019. En effet, la DGAC accepte, à ma connaissance, jusqu’à une période d’un an.
L’inspecteur de surveillance de la DSAC dont vous dépendez, devrait vous renvoyer le scan du document signé et tamponné, sous la forme d’un fichier PDF, par e-mail. C’est sous cette forme que je l’ai reçu venant de la DSAC Ouest dont je dépends. Il vous suffira ensuite de l’annexer à votre MAP, pour pouvoir le présenter lors d’un éventuel contrôle sur le terrain, lors de votre activité professionnelle.
Bonnes missions de captation aérienne,
Merci Denis pour toutes ces précisions
Cordialement et bons vols à vous aussi
Philippe
Bonjour, je réalise des clichés aériens avec un drone que je partage sur ma page Facebook publique pour mon loisir. Je n’en retire aucune rémunération. Tous les clichés sont réalisés dans le respect de la réglementation ( altitude max et zone autorisée sur Géoportail). Est ce légal ? Merci à vous pour cet article de qualité !
Bonjour Julien,
Bravo de respecter l’altitude max et des zones autorisées, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. En effet, certains ne se posent malheureusement pas trop de questions. Quand d’autres réalisent aussi des survols dangereux pour les gens au sol ou les aéronefs habités.
En dehors de cette exception, il s’agit d’activités dites particulières du domaine professionnel ou d’aéronefs non habités et télépilotés (drones) de l’Etat, affrétés ou loués par lui et utilisés dans le cadre de missions de secours, de sauvetage (Sapeurs-pompiers départementalisés (CODIS) ou militaires: Pompiers de Paris, Bataillons de marins-pompiers, 3 unités de Sécurité Civile,…), de douane, de police (Gendarmerie Nationale, Police Nationale, Affaires Maritimes…) ou de sécurité civile (Sapeurs-pompiers départementalisés (CODIS) ou militaires: Pompiers de Paris, Bataillons de marins-pompiers, 3 unités de Sécurité Civile,…) qui peuvent évoluer en dérogation aux dispositions de l’arrêté du 17 décembre 2015, lorsque les circonstances de la mission et les exigences de l’ordre et de la sécurité publics le justifient.
Pour réaliser des activités particulières, la profession de pilote (avion, ulm, hélico…) ou télépilote (drone) qui réalise des captations aériennes en France est réglementée. En effet, il faut travailler pour un exploitant professionnel déclaré à la DGAC, assuré en RC aérienne professionnelle à hauteur, au minimum, de 1 million d’euros (pour les drones), avoir une DNC comme télépilote….etc…Voir: Drones et réglementation aérienne en France, pour plus d’infos. Les opérateurs professionnels étrangers peuvent également bénéficier d’un régime dérogatoire pour réaliser des captations aériennes sur le territoire français.
Voir à ce sujet: Dérogations de vols pour les opérateurs de drones et Fly a drone in France for foreigners and regulations.
Par conséquent, si on s’en tient à la réglementation qui date de plus de 12 ans (arrêté du 27 juillet 2005) et qui s’applique aussi aux autres vecteurs aériens que les drones (avion, hélico, ULM…) vous ne devriez pas faire de diffusion publique, même si l’activité ne vous apporte pas de rémunération et limiter votre partage d’images aériennes, à votre seul cercle privé: amis, famille…Je sais que cela peut paraître étonnant à la vue de tout ce que l’on peut voir circuler sur les chaînes Youtube, Vimeo… réseaux sociaux…Mais cela ne veut pas dire que c’est légal. De plus, toutes les diffusions ne concernent pas toujours la France. J’espère que ma réponse est claire.
Pour finir, vérifiez bien que vous êtes couvert, au niveau assurance, en responsabilité civile (RC), pour pratiquer le drone de loisirs, afin de pouvoir réparer les préjudices que vous pourriez créer à autrui en cas d’accident. En effet, le “risque zéro” n’existe pas, même pour de bons télépilotes et même des professionnels. Voir à ce sujet: Assurances des drones loisirs et professionnels.
Bons vols en drone et bonnes prises de vues…
Merci pour votre réponse.
Bonsoir Julien,
Avec plaisir…Bons vols et prises de vues
Bonjour,
Merci pour ce partage intéressant et qui m’a permis d’y voir plus clair. Je suis exploitant pro. Je croise ou j’entends régulièrement parler dans ma région de photographes qui font de la prise de vues aérienne en drone sans être déclarés, par exemple, pour les mariages. Cela commence sérieusement à m’énerver. On s’emerde à respecter la réglementation quand d’autres agissent en toute impunité et sans contraintes…
Pour info, la FFD (www.federation-francaise-drone.com) va dans le même sens que votre proposition mais uniquement pour les vidéos prises par drones. Voir son Flash actu n°1 de novembre 2017:
https://www.federation-francaise-drone.com/wp-content/uploads/Bibliothèque/60_Publications/FlashActu/FLASH_ACTU_FFD_n°1-Novembre_2017.pdf
Bonjour,
Merci pour votre témoignage. Pour rappel, le survol de personnes est interdit, donc pour un groupe de mariage, les possibilités sont normalement très limitées. Merci aussi pour l’info de la FFD, mais j’en avais déjà connaissance. Effectivement, cela serait bien pour toute la filière de prendre certaines mesures pour limiter les dérives dans le domaine.
Bonjour,
Merci pour votre article bien documenté.
A la Réunion, on est aussi confronté à la concurrence déloyale d’amateurs qui “travaillent au black” et aux survols illégaux. Je souscrits à votre idée de numéro de déclaration d’exploitant à la DGAC mentionné pour chaque vidéo ou photo. La liste des exploitants mise à jour par la DGAC devrait l’être plus souvent et surtout plus accessible. Pas cachée au bas d’une page de la DGAC perdue dans les méandres du site du Ministère de la Transition écologique et solidaire. Pourquoi pas bien en vue, depuis la page d’accueil de mon espace drone, nouveau portail drones de la DGAC pour les pros ? : https://monespacedrone.dsac.aviation-civile.gouv.fr Il faudrait aussi que les pouvoirs publics fassent plus de contrôles des amateurs dronistes qui font parfois n’importe quoi. Il faut dire qu’aujourd’hui, ils ont souvent aucune formation et que c’est assez facile d’acheter un drone…
Bonjour Hervé,
Merci pour votre témoignage. Si besoin, il est possible de faire un signalement pour les cas les plus graves à la Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens (BGTA) qui pour la Réunion, doit être rattachée à l’aéroport Roland Garros. La Réunion vue d’en haut doit être magnifique ! Bonnes missions et bons vols.
Merci pour cet article intéressant. Vous voulez un exemple de survol illégal, en dehors de la réglementation, par un télépilote non professionnel et sans considération pour la sécurité !
Le directeur général du domaine de Chambord interviewé en direct sur la page Facebook du Monde par une journaliste du Monde lors d’un survol illégal en drone, vraisemblablement par un télépilote non déclaré à la DGAC, dans le domaine de Chambord et en dehors de toute considération liée à la sécurité. Survol du public qui visitait le château, présence de jeunes enfants à proximité du drone en vol…Je ne serais pas étonné que le drone utilisé soit un DJI Mavic Pro, à la vue de la télécommande miniature.
Voir ce lien:
http://www.lemonde.fr/culture/article/2017/04/11/en-direct-partez-a-la-decouverte-des-nouveaux-jardins-du-chateau-de-chambord_5109630_3246.html
Merci pour votre commentaire et vos encouragements. Je viens d’aller voir votre lien. C’est une belle caricature sur le sujet ! Il y a encore de l’information à faire. A la vue des images tournées, le télépilote n’était, semble-t-il, pas un professionnel. En effet, les images montrent beaucoup trop de liberté prise avec la réglementation et la sécurité: survol du public, pas de zone d’exclusion des tiers, distance horizontale de vol….. En plus, il s’agit d’un établissement public, classé monument historique, ouvert au public. Pour cette raison, il est interdit de survol, du sol à 1300 pieds (environ 396 mètres), car protégé par la zone R96 (zone aérienne réglementée, définie par l’aviation civile pour protéger un lieu). Pour pouvoir y voler, il est nécessaire d’obtenir, au préalable, une dérogation exceptionnelle, délivrée par les services de la préfecture du Loir et Cher, après avis de la DSAC Ouest et du directeur général du domaine de Chambord (l’interviewé).